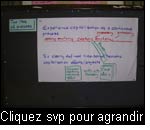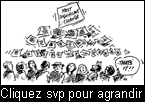InfoResources News No 5 /
05 (Novembre 2005)
Article de fond
> Biotechnologie et
foresterie : des potentiels dont il faudra
débattre en Afrique
D'intérêt courant
Politique
> La transition rural-urbain pourrait offrir
un avenir aux petites
exploitations agricoles
> Le potentiel négligé de l'eau
verte
> L'intégration
économique à l'échelle régionale aide l'Afrique
> 89
paragraphes sur l'intégration des minorités dans la planification
des ODM
> Les
communautés marginalisées font valoir leurs droits
Mise en oeuvre
> Des
offres de formation dans le monde entier en un clic de souris
> Paiement
contre résultat
> Les
projets de développement apprennent de leurs expériences
> Des
entreprises associatives rurales posent les jalons de leur viabilité
> Recueillir
des histoires pour analyser les effets de projets
Biotechnologie et foresterie : des potentiels dont il faudra débattre
en Afrique  La
biotechnologie ne se résume pas seulement à la production
d'OGM. La Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique
(CDB) la définit ainsi : « toute application technologique
qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants,
ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier
des produits ou des procédés à usage spécifique
». En partant de cette définition, les biotechnologies
peuvent être caractérisées en trois groupes : les
anciennes (la domestication d'espèces), les classiques (processus
industriels de fermentation, transformations chimiques pour la production
de médicaments, produits de synthèse) et enfin les modernes. La
biotechnologie ne se résume pas seulement à la production
d'OGM. La Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique
(CDB) la définit ainsi : « toute application technologique
qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants,
ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier
des produits ou des procédés à usage spécifique
». En partant de cette définition, les biotechnologies
peuvent être caractérisées en trois groupes : les
anciennes (la domestication d'espèces), les classiques (processus
industriels de fermentation, transformations chimiques pour la production
de médicaments, produits de synthèse) et enfin les modernes.
Dans le cadre de la foresterie en Afrique, et notamment dans le Bassin
du Congo, l'utilisation des biotechnologies pour l'amélioration
des ressources peut couvrir plusieurs aspects :
- l'identification des ressources génétiques
- la multiplication des espèces
- la modification génétique d'espèces d'arbres
- la production de fertilisants biologiques et la recherche de micro-organismes
antagonistes.
L'identification des ressources génétiques
permet tout d'abord de passer des descriptions morphologiques classiques
des espèces à des résultats plus fiables. Sur le
plan de la conservation des ressources naturelles, normalement basée
sur la composition des espèces, elle aiderait à préciser
la diversité génétique au sein d'une espèce.
Par exemple, de récentes recherches in situ dans une forêt
de l'Est du Cameroun ont démontré la grande variabilité
génétique du sapelli, une espèce couramment commercialisée.
De telles informations pourraient aussi être utilisées
dans la sélection des espèces, en se basant de manière
quantitative sur certains traits de caractère écologique
ou économique. Sur ce dernier point, les auteurs considèrent
la biotechnologie uniquement comme un complément – et non un
substitut – des programmes de sélection classique.
La multiplication végétative d'espèces
forestières peut être utilisée dans
des programmes forestiers pour multiplier le matériel génétique
et le stocker dans de bonnes conditions. Un peu paradoxalement, elle
peut aider à assurer une large base génétique du
matériel à diffuser et à introduire progressivement
de nouveaux clones pour maintenir la variabilité génétique
des espèces. La sélection in vitro et la culture de tissu
cellulaire sont par exemple déjà utilisées au Cameroun
(hévéa, cacao, café) et en République Démocratique
du Congo (arbres à usages multiples, comme Acacia auriculiformis
et Leucaena leucocephala). En complément, la cryoconservation
et la conservation in vitro permettent quant à elles la réduction
du risque de maladies menaçant les banques de gènes.
La modification génétique d'arbres
intéresse de nombreux spécialistes, en particulier pour
les espèces à croissance rapide et donc de production
intensive. Les dangers sont liés aux possibilités de «
cross pollination » avec des espèces naturelles, surtout
à proximité des centres d'origine des espèces.
Enfin, des domaines moins courants, comme la recherche sur les micro-organismes
antagonistes d'insectes nuisibles qui peuvent fertiliser le sol et améliorer
la production d'une espèce, pourraient également bénéficier
de biotechnologies.
Malgré ces apports possibles des biotechnologies, la plupart
des pays africains présentent des défaillances sévères
au niveau du matériel et des compétences spécialisées
dans ce domaine. Le débat sur l'utilisation de biotechnologies
modernes, en particulier en Afrique vu sa biodiversité, devrait
être mené de manière ouverte avec la société,
donnant la parole aux spécialistes locaux disposant d'informations
pertinentes et fiables.
Source: Potential contributions
of biotechnologies in the management and conservation of forest resources
of the Congo basin. D.J. Sonwa … [et al.]. In: International Forestry
Review vol. 7, no 1, 2005. p. 59 – 62
Information supplémentaire:
Forest Genetic Resources Nº 31, FAO, 2004, 80 p.
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/y5901e/y5901e00.pdf

D'intérêt
courant: Politique
La transition rural-urbain pourrait offrir un avenir aux petites
exploitations agricoles
Les petites exploitations agricoles ont un avenir, même en Afrique
subsaharienne : tel est l'avis qui s'est dégagé d'un atelier
consacré aux perspectives de la petite paysannerie. En Afrique
subsaharienne, la majeure partie de la population travaille dans l'agriculture,
mais les exploitations tendent à devenir de plus en plus petites,
allant jusqu'à la simple agriculture de subsistance. Le moindre
changement dans les conditions environnementales ambiantes perturbe
gravement les efforts pour assurer l'alimentation. Les modèles
qui promettent une augmentation des revenus dans l'agriculture sont
difficilement applicables dans les régions rurales d'Afrique
subsaharienne. La révolution verte qui a fait ses preuves en
Asie ne peut pas être simplement transposée ici, car les
plantes et les techniques de culture y sont différentes. Selon
l'auteur, les optimistes sous-estiment les effets négatifs de
la libéralisation des marchés et de la parcellisation
des exploitations agricoles. Pour lui, s'il reste important de développer
des stratégies de lutte contre la pauvreté axées
sur l'amélioration des récoltes, il est tout aussi important
d'accélérer la transition rural-urbain, c.à.d.
miser davantage sur le commerce et les services. La mobilité
des personnes est à son avis le principal facteur de croissance
: les projets de réduction de la pauvreté seraient les
plus efficaces là où le développement économique
est déjà en marche et où il existe des infrastructures,
des moyens de transport et de communication.
Source: Small-Farms, Livelihood Diversification
and Rural-Urban Transitions: Strategic Issues in Sub-Saharan Africa.
Frank Ellis. Overseas Development Group (ODG), University of East Anglia.
Paper prepared for the Research Workshop on: The Future of Small Farms,
by organized IFPRI/ODI/Imperial College, London 26 – 29 June 2005. 18
p. . www.ifpri.org/events/seminars/2005/smallfarms/ellis.pdf
Le potentiel négligé de l'eau verte
Il y a plusieurs sortes d'eau. Et cette ressource recèle plus
d'aspects encore que ceux pris en compte jusqu'à maintenant les
politiciens du développement et les hydrologues dans leurs concepts
d'approvisionnement en eau. Que veut-on dire par là ? Il n'y
a pas seulement l'eau bleue (l'eau des rivières et des nappes
aquifères), mais aussi l'eau verte, soit 65% des précipitations
qui restent dans le sol sous forme d'humidité, sont ensuite stockées
dans les plantes pendant la croissance, et qui sont finalement renvoyées
dans l'atmosphère par évaporation.
70% de la population des régions rurales vivent de l'agriculture
pluviale. Dans ces régions pauvres en eau, l'alimentation et
l'approvisionnement en eau ne peuvent plus être garantis seulement
par une meilleure gestion de l'eau bleue. Il faut au contraire élargir
l'approche et placer l'eau verte et son exploitation au centre des efforts.
Un nouveau document stratégique du Stockholm International Water
Institute démontre l'importance du cycle de l'eau verte pour
l'humanité, à l'aide de modèles des cycles de l'eau
et de cartes géographiques. Plusieurs communautés de chercheurs
(le Fonds international de développement agricole et le Global
Water Systems Program) travaillent d'ores et déjà sur
des « projets eau verte » prometteurs.
Source: Rain: The Neglected Resource.
M. Falkenmark, J. Rockström. 2005. Swedish Water House Policy Brief
Nr. 2. Stockholm International Water Institute (SIWI). 16 p.
www.siwi.org/downloads/Reports/2005_Blue_Green_Policy_Brief.pdf
L'intégration économique à l'échelle
régionale aide l'Afrique
En dépit de certains avantages comparatifs, p. ex. des salaires
bas, les produits des pays sub-sahariens ne peuvent s'affirmer sur les
marchés globalisés. En effet, la faible productivité,
les coûts de marketing élevés et les obstacles résiduels
aux échanges réduisent ces avantages à néant.
D'un autre côté, la demande augmente fortement en Afrique,
surtout pour les denrées alimentaires. Aujourd'hui déjà,
l'Afrique couvre 25% de ses besoins en céréales en achetant
sur les marchés internationaux. Ses importations de maïs,
par exemple, équivalent au total de ses exportations de café.
Une étude de l'International Food Policy Research Institute montre
que de nombreux pays africains importent d'outremer des produits que
leurs voisins dans la région produiraient à meilleur coût.
D'où l'importance pour les pays africains de développer
les marchés régionaux et donc de démanteler les
obstacles aux échanges entre eux. Des simulations modèles
montrent que cette mesure permettrait d'augmenter de 19% le total des
exportations de produits agricoles africains.
Des investissements coordonnés dans la promotion de la productivité
agricole régionale, dans le développement des infrastructures,
la recherche et le renforcement des institutions régionales,
pourraient stimuler la croissance économique et la compétitivité
de la région.
Source: Africa Without Borders: Building
Blocks for Regional Growth. Xinshen Diao, Michael Johnson, Sarah Gavian,
and Peter Hazell. Issue Brief No. 38. International Food Policy Research
Institute (IFPRI), July 2005. 4 p. www.ifpri.org/pubs/ib/ib38.pdf

89 paragraphes sur l'intégration des minorités
dans la planification des ODM
Même dans les sociétés défavorisées,
les minorités sont surreprésentées dans le groupe
de population des plus démunis et des plus discriminés.
Comme la protection des minorités n'est pas explicitement exigée
dans les objectifs et lignes directrices actuels des Objectifs de Développement
pour le Millénaire (ODM), la plupart des programmes correspondants
ne contiennent pas de clauses spéciales à cet effet. On
peut craindre dès lors que les plus pauvres parmi les pauvres
continueront d'être défavorisés. Aujourd'hui, cinq
ans après le Sommet onusien sur le Millénaire, la Commission
des droits de l'homme prend sous la loupe les huit objectifs essentiels
et les articles correspondants en se focalisant sur la protection des
minorités et les droits de l'homme. Selon la Commission, pour
améliorer l'intégration des droits de l'homme dans les
processus ODM au niveau national, il faut intervenir à trois
moments :
- pendant la planification
- pendant la rédaction des rapports des pays
- pendant les efforts d'advocacy.
Le document présente une large palette d'arguments solidement
étayés en faveur de la prise en compte des trois piliers
des droits de l'homme : la non-discrimination, la protection de l'identité
sociale et religieuse et la protection des droits politiques (participation).
Il fournit des éléments de réflexion et formule
des propositions concrètes sur l'intégration des droits
des minorités.
Source: The Millennium Development Goals:
Helping or Harming Minorities. Working paper. Commission on Human Rights,
Sub-Comission on Promotion and Protection of Human Rights, Working Group
on Minorities. 3 June 2005. 47 p.
www.minorityrights.org/admin/download/pdf/WGM2005-MDGs.pdf
Les communautés marginalisées font valoir leurs
droits
Les communautés dites défavorisées ont peu de moyens
de revendication quant à l'écart caractérisant
les droits communautaires décrits dans la législation
et leur application au quotidien.
« Bon, moyen & mauvais (BMM) » est un outil qui permet
d'établir si une loi en vigueur se traduit par de bons, moyens
ou mauvais effets auprès des communautés sur le terrain,
et de rectifier la situation le cas échéant. La considération
des dispositions légales, l'exploration des mécanismes
de mise en œuvre, l'identification de critères d'évaluation
représentent les pas principaux de ce processus. Ensuite, il
subsiste un important travail d'analyses comparatives à effectuer
entre des exemples jugés bon, moyen et mauvais.
Une étude en vue d'améliorer les négociations entre
les exploitants de concessions forestières et les communautés
au Mozambique a ainsi réussi à identifier 6 ajustements
légaux qui permettraient de mieux garantir les droits et bénéfices
des pauvres dont la vie est tributaire de la forêt.
Cet instrument a l'avantage de répondre à presque toutes
les problématiques concernant l'application d'une loi. Toutefois,
son usage reste très compliqué et nécessite l'intervention
d'intermédiaires avisés sur le plan méthodologique
et l'environnement communautaire.
Source: Bon, moyen et mauvais : la loi
en action. IIED, 2005. 12 p. Disponible aussi en anglais, espagnol et
portugais, à l'adresse suivante :
www.policy-powertools.org/Tools/Ensuring/GAB.html

D'intérêt
courant: Mise en oeuvre
Des offres de formation dans le monde entier en un clic de souris
Les personnes qui travaillent dans la coopération au développement
sont sans cesse confrontées à de nouvelles situations,
de nouveaux problèmes. Pour pouvoir y réagir efficacement,
elles doivent continuer à se former. Mais où trouver des
offres de formation adéquates ? Combien de temps durent-elles,
combien coûtent-elles ?
La nouvelle version de l'InfoAgrar Training Directory, élargie
au niveau thématique, est un instrument fort utile. De caractère
global, elle met l'accent sur les cours dans les pays en développement
; en plus, on y trouve des offres de formation à distance. Accessible
sur l'Internet, le registre tenu à jour en permanence contient
quelque 350 cours sur la thématique « développement
rural ». Les formations portent aussi bien sur des problématiques
techniques que sur des aspects méthodologiques et conceptuels.
On y trouve ainsi des cours sur la gestion de projet, des questions
de santé, l'accès au marché, la préservation
de la biodiversité, la production animale, etc.
L'offre peut être consultée par thème, par pays,
par institution ou par mot clé. Pour chaque cours, des informations
détaillées sont données sur les conditions, le
contenu, les coûts et l'adresse de contact de l'organisateur.
Information: Cliquez sur le lien
en bas de la page internet suivante : www.sdc-ruraldevelopment.ch/index.php?userhash=242773&lID
=2&navID=53
Paiement contre résultat
 Pourquoi
les bailleurs de fonds de projets de développement ne pourraient-ils
pas être les «acheteurs» des «produits»
offerts par leurs partenaires ? Partant de cette question provocatrice,
l'ONG suisse Helvetas a commencé à mettre en œuvre le
principe « paiement contre résultat » dans plusieurs
projets : le bailleur de fonds donne un mandat dans lequel il convient
des résultats à atteindre avec le mandaté. Celui-ci
est ensuite payé en fonction des résultats effectivement
obtenus. Pourquoi
les bailleurs de fonds de projets de développement ne pourraient-ils
pas être les «acheteurs» des «produits»
offerts par leurs partenaires ? Partant de cette question provocatrice,
l'ONG suisse Helvetas a commencé à mettre en œuvre le
principe « paiement contre résultat » dans plusieurs
projets : le bailleur de fonds donne un mandat dans lequel il convient
des résultats à atteindre avec le mandaté. Celui-ci
est ensuite payé en fonction des résultats effectivement
obtenus.
Ce système a été instauré, par exemple,
dans un projet d'amélioration des services de vulgarisation agricole
au Kirghizistan. Ces services ne sont plus payés en fonction
d'un calcul des frais, mais d'après le nombre d'interventions
ou de démonstrations réalisées, le nombre de paysans
qui ont pu augmenter leur revenu, le degré d'adaptation à
telle ou telle innovation, etc.
Les expériences sont largement positives. Par rapport au système
en vigueur jusqu'alors, basé sur un budget établi selon
les dépenses projetées, l'efficacité et l'efficience
des projets ont nettement augmenté. Cela dit, le nouveau système
ne peut fonctionner que si le mandat et les résultats à
obtenir sont soigneusement négociés, et que leurs effets
sont durables. Un monitoring sérieux et efficace des résultats
est également indispensable. Avec certaines adaptations, le concept
peut être transposé à de nombreux autres contextes.
Source: You pay for what you get. From
Budget Financing to Result Based Payments. Markus Arbenz. Experience
and Learning in International Co-operation, Helvetas Publications, No.
4. Helvetas, Zürich, August 2005.
www.helvetas.ch/global/pdf/english/Professional_competences/
Documented_experiences/Civil_Society_and_the_State/
You_pay_for_what_you_get_Publ_4.pdf

Les projets de développement apprennent de leurs expériences
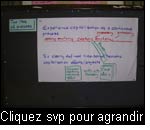 Les
projets et programmes de développement travaillent de plus en
plus avec différents partenaires locaux qui peuvent toutefois
être dispersés. Cette situation accentue le besoin d'une
stratégie qui permette de tirer des leçons des expériences
des divers axes de travail, et de les organiser afin qu'elles servent
dans le futur. Les
projets et programmes de développement travaillent de plus en
plus avec différents partenaires locaux qui peuvent toutefois
être dispersés. Cette situation accentue le besoin d'une
stratégie qui permette de tirer des leçons des expériences
des divers axes de travail, et de les organiser afin qu'elles servent
dans le futur.
Au Bangladesh, le projet Livelihoods, Empowerment and Agroforestry (IC-LEAF)
voit la capitalisation comme un processus continuel d'apprentissage
et de changement mené par les différents acteurs du projet
à partir de leurs expériences. LEAF définit le
produit de la capitalisation comme un capital, appelé à
être investi à nouveau. L'élément novateur
réside dans l'intérêt et le suivi que porte le projet
au « comment » et au « pourquoi » un objectif
a été atteint, plutôt que « quel » objectif
a été atteint. Cet aspect distingue la capitalisation
d'expérience des « success stories ».
L'article montre comment une telle approche se met en place et explique
toutes les étapes ainsi que l'organisation du processus. Les
responsables de projets de développement y trouveront un pont
vers la gestion des connaissances.
Source: Experience capitalisation: Elements
for a strategy in dispersed projects. Compil. Elisabeth Katz. LBL. In:
Rural Development, No 2/2005, p. 21 – 25. www.lbl.ch/internat/services/publ/bn/2005/02/
experience_capitalisation.pdf
Des entreprises associatives rurales posent les jalons de leur viabilité
En Amérique latine, de petites unités de production
dans le secteur de l'agriculture/élevage se groupent en entreprises
de manière à être plus fortes dans la concurrence
aux grandes entreprises. Ceci avec l'aide de l'Etat et également
de la coopération internationale.
Une étude de cas d'entreprises associatives rurales a analysé
35 entreprises de ce type dans 7 pays latino-américains, selon
une méthodologie commune et des critères de sélection
des cas établis. Des conclusions ont été tirées
au niveau de chaque pays, puis au niveau régional.
Pour la zone andine notamment, dix facteurs de succès des expériences
de ces entreprises ont été retenus, comme la nécessité
de la proximité du marché, l'assurance du fonctionnement
démocratique au sein de l'entreprise, la capacité de développer
des alliances avec les différents agents du marché, ainsi
qu'un environnement favorable. Par ailleurs, l'étude a gardé
en point de mire la question de l'équilibre entre l'accumulation
sociale de l'entreprise, le bénéfice individuel des associés
et les conditions de bien-être des producteurs.
Ces conclusions sont appelées à servir les orientations
futures du marché rural dans la région, ainsi que l'implication
de tous les acteurs : les producteurs, les propriétaires d'entreprises,
les entités privées de développement (ONG et projets),
ainsi que les représentants du secteur public liés à
cette thématique.
Source: Estudio regional sobre
factores de éxito de empresas asociativas rurales. Informe síntesis
regional en base a los informes nacionales. Patricia Camacho, Christian
Marlin, Carlos Zambrano. Ruralter, 2005. 47 p. Accessible à partir
de décembre 2005 sur :
www.ruralter.org
www.asocam.org
Recueillir des histoires pour analyser les effets de projets
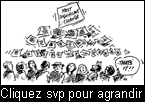 Cet
ouvrage décrit une nouvelle approche (Most Significant Change
Technique MSC) pour analyser de manière participative les effets
d'un projet. A l'aide de questions clés ouvertes adressées
à la population concernée, sont recueillies des histoires
qui décrivent aussi bien que possible les changements que les
projets ont opérés dans le contexte local et comment ces
changements ont été perçus. Dans une procédure
participative de sélection, sont choisies les histoires les plus
parlantes et on les soumet à une analyse systématisée.
L'accent est mis sur les résultats à moyen et à
long termes. Cet
ouvrage décrit une nouvelle approche (Most Significant Change
Technique MSC) pour analyser de manière participative les effets
d'un projet. A l'aide de questions clés ouvertes adressées
à la population concernée, sont recueillies des histoires
qui décrivent aussi bien que possible les changements que les
projets ont opérés dans le contexte local et comment ces
changements ont été perçus. Dans une procédure
participative de sélection, sont choisies les histoires les plus
parlantes et on les soumet à une analyse systématisée.
L'accent est mis sur les résultats à moyen et à
long termes.
L'ouvrage est articulé en deux parties. Les cinq premiers chapitres
introduisent à la méthode et peuvent être utilisés
comme un manuel. Les cinq chapitres suivants expliquent les fondements
théoriques du MSC et donnent des informations complémentaires.
Pourtant, on se rend compte seulement en cours de lecture qu'il ne s'agit
pas d'une méthode complète de monitoring et d'évaluation,
mais plutôt d'un outil pour compléter des approches existantes.
La procédure d'analyse, peu standardisée, laisse à
l'utilisateur une grande marge de discussion et d'interprétation.
Elle convient donc surtout pour des discussions entre parties prenantes
ainsi que pour des processus d'apprentissage et de consensus entre groupes
d'utilisateurs.
Source: The “Most
Significant Change” (MSC) Technique. A guide to its use. Rick Davies
and Jess Dart. April 2005. 104 p. www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.htm

|